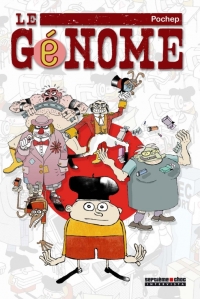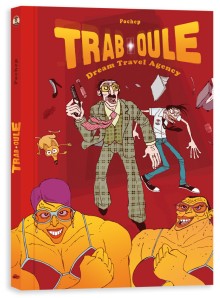Cet article m’a été inspiré par un billet de Sébastien Naeco sur son blog le comptoir de la bd. Il s’interrogeait sur les enjeux de la conservation de la bande dessinée numérique. On pourrait considérer la question comme peu importante alors même que le modèle économique est extrêmement mouvant et diversifié. Néanmoins, il est certain qu’un véritable patrimoine graphique est en train de se former et que sa sauvegarde à long terme (c’est-à-dire pour les générations futures) va poser des problèmes. Lors de la table ronde sur la bande dessinée numérique à l’enssib, Catherine Ferreyrolle, de la Cité de la BD, avait donné l’exemple d’un site Internet sur la patrimoine de la bande dessinée qui avait dû disparaître de la toile et qui a été sauvé de justesse.
Le bon côté, c’est que la bande dessinée est loin d’être seule face à ce problème. C’est la création numérique dans son ensemble, en ligne ou hors ligne, qui pose la question de sa conservation. Car je pense avant tout à la bande dessinée numérique native, celle qui n’a aucun équivalent papier (à part peut-être l’original de son créateur). Conserver les documents numériques, c’est autant pour d »éventuels lecteurs du futur curieux de la culture des années 2000 que, à moyen terme, pour les chercheurs susceptibles de travailler sur la bande dessinée numérique. Dans ces deux articles, je vais aborder cette question sous l’angle que je maîtrise le mieux : la conservation institutionnelle par des établissements publics, en l’occurence les bibliothèques (on reste encore symboliquement dans le domaine du livre).
Deux pistes me semblent envisageables pour considérer la conservation institutionnelle de la bande dessinée numérique : la mise en place progressive d’un dépôt légal pour les e-books et le dépôt légal du Web, en fonctionnement en France depuis 2007.
Le dépôt légal du Web français
Le dépôt légal du Web, mis en place à la Bibliothèque nationale de France et à l’Ina depuis 2006-2007, peut être une solution pour la conservation du patrimoine de la bande dessinée numérique, ou au moins de son versant diffusé en ligne, qui représente déjà une part importante. L’idée d’archiver Internet peut paraître absurde. Pourtant, elle est présente depuis longtemps. Le projet le plus ambitieux est celui de l’association Internet Archive qui, dès 1996, commence à archiver les sites web selon un principe de captures à des dates précises. Je vous invite à consulter leur Wayback machine (http://www.archive.org/) qui permet d’accéder à des versions antérieures de sites Internet. Vous verrez que tout est loin d’être parfait dans cet archivage qui 1. capte un nombre limité de site, à une profondeur limitée dans le site et à un nombre limité de dates ; 2. a du mal parfois avec certains formats, notamment les formats image. Mais c’est une première expérience qui a le mérite d’exister, et presque depuis les débuts du Web.

La Wayback machine d'Internet Archive peut vous permettre de visualiser les aspects successifs de sites Internet : ici le vénérable du9.org en 2005.
En quoi consiste le dépôt légal officiel en France ? En 2006, la loi DADVSI met en place les modalités d’un dépôt légal du Web français qui devient opérationnel en 2008 :
La logique n’est pas celle du dépôt volontaire mais de la collecte automatique : des robots « moissonnent » les sites Internet pour en extraire les données, sans obligation de la part du responsable du site de se signaler. Cependant, un administrateur de site Web peut faire une demande spécifique s’il souhaite être collecté.
La collecte ne se veut pas exhaustive mais « représentative ». Ce qui signifie qu’on procède à deux types de collecte : des collectes « légères », ponctuelles et superficielles sur un grand nombre de sites où l’on ne va pas chercher très profondément ; des collectes « lourdes » ciblées sur un ensemble thématique de sites en nombre réduit, où la captation tend à être complètes sur le sujet donné.
Le périmètre d’action est le suivant : les sites internet en .fr, ainsi que certains sites en .com, .org, .net quand les personnes qui le gèrent sont domiciliées en France. La liste des sites en .fr est maintenue à jour par l’AFNIC. Les intranet, parties privées des réseaux sociaux et messageries personnelles sont bien sûr exclues.
La collecte est partagée entre la Bibliothèque nationale de France et l’Institut national de l’audiovisuel (pour les sites dans la thématique audiovisuel : webtv, sites institutionnel de chaînes, etc.).
A l’heure actuelle, la principale préoccupation est la conservation, pas encore la diffusion. Les sites web archivés depuis 2008 sont consultables à un seul endroit : les salles de recherche de la bibliothèque nationale de France, à Paris, sur un moteur de recherche relativement limité dans ses fonctions pour le moment (ont été versées dans ce moteur de recherche les archives d’Internet Archive depuis 1996 ; de fait, le moteur de recherche ressemble à la Wayback machine). Il y a donc encore du chemin à parcourir pour passer de la conservation à l’accès à ce patrimoine, mais pour le moment, au moins les chercheurs peuvent y accéder. En 2010, une enquête a été réalisée pour savoir les attentes et les usages possibles de ce patrimoine pour le public.
Evidemment, et pour conclure, la principale lacune de cet archivage du Web (dont sont conscients ses responsables) est la contradiction entre la nature de « flux » d’Internet, dont le contenu est sans cesse en mouvement, et la logique de collectes ponctuelles. Cette solution a été choisie comme un compromis technique et économique, ainsi que pour faciliter la consultation du fonds qui peut se faire par dates ciblées. Toutefois, la sélection qui est opérée reste relativement empirique, et obtenir une « représentativité » dans le choix des sites moissonnées est une gageure.
L’intérêt du dépôt légal du Web pour la bande dessinée numérique

Ce que pourrait permettre l'archivage du Web pour la bande dessinée numérique : ici le site Webcomics.fr en 2007 (Internet Archive).
A première vue, le dépôt légal du Web permet de pallier aux problèmes que nous avons vu précédemment à propos d’un dépôt légale « livre ». Il serait plus adapté aux contenus et aux formats web des bandes dessinées numériques pour la simple raison qu’il est adapté pour collecter des formats Web, parmi les plus courants dans la diffusion de bandes dessinées en ligne. Il faut bien imaginer, cependant, que rester sur le dépôt légal du Web serait prendre une voie totalement divergente avec l’équivalent papier de la bande dessinée. Ce qui, dans le fond, ne serait pas une mauvaise chose : exporter les gestes et les techniques du format papier vers le format numérique n’est pas toujours une bonne chose, et peut restreindre la créativité d’une forme d’expression encore neuve.
D’emblée, n’oublions pas que ce dépôt légal du Web est pragmatiquement la modalité de collecte actuelle de la bande dessinée numérique diffusée sur Internet, comme des autres livres numériques. Un exemple est celui des blogs bd : parmi les thématiques choisies pour les collectes « lourdes » en profondeur se trouvait la collecte des sites personnels et de l’écriture de soi. L’objectif de ce thème était naturellement de se pencher sur le problème spécifique des blogs et de leur vitesse de mise à jour. La sélection était réalisée en collaboration avec l’Association pour l’autobiographie et le patrimoine autobiographique (voir à ce sujet le mémoire de Carole Daffini, Dépôt légal numérique : l’archivage des blogs adolescents, janvier 2011. Or, parmi les choix de sites personnels se trouvaient des blogs bd, dont « Les toujours ouvrables » de Soph’ si ma mémoire est bonne : la mise en place de la collecte a eu lieu en 2007, en pleine mode du blog bd, et cette dimension graphique de l’écriture « extime » avait été prise en compte. Cette sélection thématique est disponible sur les ordinateurs du rez-de-jardin de la BnF c’est-à-dire, là encore, pour les chercheurs. Pour l’instant, nous sommes toujours dans la logique de l’échantillonage, pas de l’exhaustivité de la production.
A titre de comparaison, je signale aussi que, dans le cas du livre électronique, la BnF a conclu en 2009 des accords avec certains éditeurs numériques, dont publie.net, pour avoir accès à leur catalogue d’ouvrages numériques et pouvoir les collecter via le site de l’éditeur, de la même manière que sont collectés les autres contenus web. Toutefois, le marché payant de la bande dessinée numérique native n’est pas encore aussi bien développé que pour le livre numérique. On pourrait toutefois imaginer que Ave!comics ou Thomas Cadène pour les Autres gens donnent leur aval pour une collecte des oeuvres diffusés via leur site par les robots de la BnF. En effet, dans le cas de l’offre payante, l’accès ou le téléchargement sont souvent soumis à des codes et des barrières que les robots ne peuvent pas passer. Quant à savoir si la foisonnante offre de bandes dessinées numériques gratuites est collectée, je ne saurais vous le dire : sans doute une petite partie fait l’objet de collectes ponctuelles à l’heure actuelle.
Parmi les pistes à l’étude à la BnF pour les livres numériques en général, Sophie Derrot proposait dans son mémoire déjà cité dans l’article précédent une collecte ciblée qui supposerait d’établir une liste de sites, en se concentrant sur les plate-formes de diffusion, avec une profondeur de collecte maximale. Cette liste permettrait de rationaliser la collecte et d’avoir une idée précise des oeuvres conservées. Dans cette liste, S. Derrot incluait pour l’offre payante en bande dessinée numérique Digibidi, Ave!comics, Izneo, c’est-à-dire principalement des diffuseurs d’oeuvres numérisées. En farouche militant de la reconnaissance d’une bande dessinée numérique native originale et de qualité, je ne saurais trop conseiller d’étendre cette liste à des éditeurs spécifiques (tels que Foolstrip).
Le choix de l’archivage du Web n’est pas sans poser d’autres problèmes, malgré tout, si on le situe dans le contexte précis de l’histoire du développement de la bande dessinée numérique :
Le principal écueil est qu’il se limite aux oeuvres diffusées en ligne. C’est certes une grosse partie de la production, et, à l’avenir, Internet semble s’imposer comme le moyen de diffusion unique pour les oeuvres numériques.
Beaucoup de webcomics obéissent à une logique de flux, qu’il s’agisse des blogs bd ou des productions de strips (portail Lapin…). Cette particularité risque d’être mal prise en compte dans le cas de collectes ponctuelles.
Il faudra assurer une bonne maîtrise, tant par les robots de collecte que par les interfaces de lecture, des formats images, dont certains formats « animés », qui sont ceux de la bande dessinée numérique. Beaucoup de bandes dessinées numériques sont proposées dans des interfaces de lecture en flash.
Le type de collecte pratiquée dans le cadre du dépôt légal du Web n’isole pas l’entité « oeuvre », il collecte en masse le site qui diffuse les oeuvres, mais sans avoir l’assurance que ces oeuvres sont bien identifiables par leurs métadonnées descriptives (auteur, mots-clés, date, etc.) et donc susceptibles d’être signalées au lecteur avec autant de précisions que dans un catalogue d’ouvrages papier. A terme, il peut y avoir un défaut d’identification claire de la production et des auteurs.
Mais le principal écueil tient selon moins à la focalisation qui est faite actuellement, dans les réflexions menées sur le dépôt légal du livre numérique, sur l’offre payante. Si, dans le cas de la littérature « texte » le défi de rassembler la production auto-éditée et gratuite peut sembler vertigineux tant le texte est le mode d’expression dominant sur Internet, dans le cas de la bande dessinée, il existe des sites bien identifiables qui donnent accès à une partie bien représentative. Surtout, l’accès payant est pour l’instant le mode de diffusion dominant dans la bande dessinée numérique en ligne. L’ignorer conduirait à biaiser la lecture de la production de bandes dessinées numériques que pourront avoir les générations futures. Pour me situer sur le terrain de l’histoire qui est celui où je suis le plus à l’aise, il m’est difficile d’imaginer un « historien » de la bande dessinée qui essaierait de comprendre la production papier sans savoir ce qui se publie en ligne ! Car, à terme, c’est bien là l’objectif principal d’un dépôt légal des oeuvres numériques : permettre aux lecteurs du futur (proche ou lointain) d’avoir un aperçu suffisamment exact du patrimoine du début du XXIe siècle. Le sauvegarder, comme la sauvegarde des premiers livres imprimés nous permet d’avoir accès au savoir et à la création tels qu’ils se diffusaient au XVIe siècle.
Pour conclure ces deux articles, je souhaite insister sur le fait que leur objectif n’était pas d’apporter des solutions (j’en serais bien incapable à ma modeste échelle) mais de présenter les conditions actuelles qui pourraient servir de cadre à une conservation institutionnelle de la production de bandes dessinées numériques. Il me semble important que, d’une part les créateurs, éditeurs et diffuseurs numérique sachent que cette solution existe, et d’autre part que les responsables de la conservation numérique n’oublient pas le champ certes marginal, mais néanmoins important et riche, de la bande dessinée. Ce n’est pas parce que ce secteur prend son temps pour se transformer en une industrie culturelle numérique « modèle » qu’il faut pour autant l’oublier.
Quelques liens sur le dépôt légal du Web :
Une présentation sur le site de la BnF à propos des procédures de dépôt légal des sites web.
Une courte histoire du dépôt légal d’Internet avant sa prise en charge par la BnF en 2007.
Le podcast d’une émission de France Culture dans laquelle Gildas Illien vient parler de l’archivage des « blogs extimes » (février 2011).
Pour en savoir plus sur les aspects techniques, un article de Gildas Illien dans le Bulletin des bibliothèques de France en ligne.