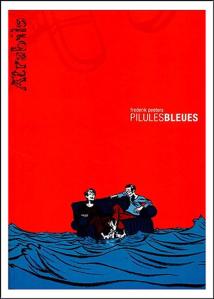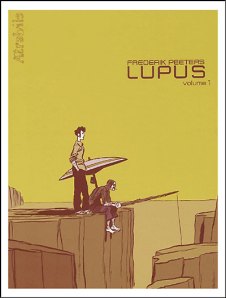Je reprends le cours de ma réflexion sur les blogs bd (qui commence avec cet article) avec une nouvelle série d’articles. Je vais tenter de vous présenter un certain nombre de blogueurs, et particulièrement ceux qui poursuivent en parallèle une carrière d’auteur de bd et publient régulièrement, en format papier ou numérique. L’occasion aussi pour moi de vous faire découvrir des auteurs parfois trop peu connus en dehors de la blogosphère.
Contredisant ainsi magnifiquement ma dernière phrase, je commence avec un des blogueurs bd les plus connus, Boulet, sans doute le meilleur exemple de la possibilité qu’offre le format blog pour déployer et développer des talents. Mais Boulet est aussi et avant tout un auteur ayant déjà derrière lui une carrière, par laquelle je vais commencer. (Bouletcorp )
Un parcours solide dans la bd papier
C’est dans le secteur de la BD jeunesse que Boulet fait ses premières armes, dans le magazine Tchô !. Ce petit magazine mensuel, conçu autour du personnage à succès Titeuf de Zep, apparaît en kiosque à l’automne 1998 et fait progressivement son nid dans le paysage de la presse jeunesse française en augmentant sa pagination et son format. Mené par Jean-Claude Camano, il propose, outre la prépublication de Titeuf, des séries principalement humoristiques. Le jeune Gilles Roussel est repéré au festival de Sierre par Jean-Claude Camano et devient un des auteurs réguliers du journal avec plusieurs séries récurrentes : La rubrique scientifique et Le Miya en 2000, Raghnarok et Les Womoks en 2001 qu’il scénarise, avec Reno au dessin, une de ses anciennes connaissances des Arts Déco (Pourquoi je hais Reno ). Il signe alors Boulet, pseudonyme qu’il gardera par la suite. Sa participation à Tchô ! lui donne une discipline de travail et le professionnalise en cotoyant ses aînés. Elle lui permet aussi de publier ses premiers albums chez Glénat, qui édite le magazine de Titeuf. C’est ainsi que La rubrique scientifique, Raghnarok et Les Womoks deviennent des séries régulières dès 2001-2002, les deux derniers passant du statut de suite de gags courts à de véritables histoires suivies. Boulet y montre sa capacité à renouveler la BD jeunesse en parodiant des univers de fantasy et de science-fiction et en réalisant des albums qui, il faut bien l’avouer, ne sont pas destinés qu’aux enfants !
C’est donc surtout par Tchô que Boulet est connu lorsqu’il lance son blog en juillet 2004 (Une pub éhontée ). Mais d’autres projets vont vite venir s’ajouter à sa production déjà conséquente, et en particulier en 2006 la reprise du dessin de la série Donjon zénith crée par Joann Sfar et Lewis Trondheim qui restent au scénario. L’enjeu est de taille : Donjon est une saga à grand succès à laquelle de nombreux dessinateurs ont participé et Zénith en est la série centrale, dessinée à l’origine par Lewis Trondheim, un auteur reconnu dont le palmarès n’est plus à évoquer. Dans cette parodie d’heroic-fantasy à l’origine réalisée dans le style minimaliste de Trondheim, Boulet fait preuve d’une grande capacité d’adaptation en imposant, dès son premier album, Un mariage à part (le tome 5 de la série), l’efficacité de son propre style qui tranche nettement par un plus grand réalisme et des scènes d’action plus nombreuses et plus dynamiques. Hasard du scénario ou force du dessin de Boulet, la série quitte progressivement sa dimension entièrement parodique pour se plonger plus avant dans l’aventure héroïque. Il transforme l’essai en dessinant en 2007 le tome 6, Retour en fanfare, où les évolutions précédentes sont encore accentuées. Sa participation à la série Donjon lui permet de mettre un pied dans la BD adulte tout en restant fidèle à Tchô puisqu’il poursuit Raghnarok, sa série principale.
Les débuts du blog et ses prolongements papier
C’est principalement à travers son blog qu’il étend son public et déploie sa capacité de dessin et d’humour sur un support plus libre. Boulet fait partie de la communauté des tous premiers blogueurs, celle qui se forme avant 2005 et se compose d’auteurs, souvent professionnels, et se connaissant déjà hors du monde des blogs. Ainsi, Boulet avoue dans sa première note (Le comment du pourquoi http://www.bouletcorp.com/blog/index.php?date=20040728 ) que l’idée d’un blog lui a été suggéré par Mélaka, la compagne de Reno, le dessinateur des Womoks qui, lui-même tient un blog à ce moment-là. Parmi les autres dessinateurs, on trouve Poipoipanda, qui dessinera à partir de 2007 Ange le terrible dans Tchô !, le couple Capu et Libon (Auteur de Jacques le petit lézard géant dans Spirou à partir de 2004), Laurel et Cha qui animent avec Mélaka la rubrique 33 rue Carambole dans le même Spirou, Lisa Mandel qui dessine Nini Patalo dans Tchô !… Un petit monde qui, dans l’ensemble, se cotoie et se connaît.
Le succès rapide du blog de Boulet, intitulé Bouletcorp, vient de l’appropriation particulière que le dessinateur a de ce format. Il poste très régulièrement, et la plupart du temps au moins un strip voire une planche, ce qui n’est pas le cas de tous les blogueurs. De plus, le blog est très agréable visuellement, réalisé dans un format flash qui facilite la navigation et changeant d’habillage deux fois par an ; il est connu pour ses petits bruitages et ses monstres qui parsèment l’écran. Cette esthétique qui, là aussi, tranche avec celle des autres blogs, plus minimalistes et artisanaux, a certainement une grande part dans le succès du blog. Un public est rapidement fidélisé et Boulet devient, consciemment ou non, une importante référence de la blogosphère bd. Un tel succès n’était certainement pas prévu au départ, au moment où le noyau des blogueurs était encore restreint, mais force est de constater que son blog est devenu, pour les amateurs du genre, incontournable. C’est lui que les organisateurs du festiblog choisissent comme parrain de la première édition avec, à ses côtés comme marraine, Mélaka.
Boulet utilise le potentiel de liberté que lui offre le blog en diversifiant énormément ses dessins : parfois de simples croquis ou des anecdotes, parfois des planches très soignées, parfois des brêves en quelques cases ; il se sert également du blog pour présenter aux lecteurs ses différents travaux et séances de dédicaces. Comme sur les autres blogs, il introduit une interaction avec les lecteurs ; l’espace commentaires, par exemple, n’a jamais été fermé.
Surtout, Bouletcorp devient l’espace où bouillonne l’imagination extrêmement fertile de Boulet, le format souple permettant à cette imagination de partir dans tous les sens. Il y a en cinq ans une réelle progression, des quelques cases crayonnées aux planches et essais graphiques qui les suivent. Boulet peut y présenter un projet inachevé, réaliser la page d’un album qui n’existera jamais mais dont il rêve (Marcinelle mon amour ). Boulet joue sur le rôle habituellement attribué aux blogs, raconter en images des anecdotes de vie, en dépassant la banalité du quotidien par le dessin, l’humour et l’imagination (Bêtises ). Un univers se crée autour de Bouletcorp, avec ses récurrences connues de tous les fans : la raclette mutante, les dinosaures, les superpouvoirs, les tournées de bières avec des amis, les compte-rendu de festivals, les zombies, les geeks…
Le blog lui permet de poursuivre d’autres projets via internet, puis sur papier. Il est l’un des cinq Chicou-chicou (http://www.chicou-chicou.com/), masqué sous le personnage d’Ella, et anime cet autre blog fameux jusqu’à sa parution en album en 2008 chez Delcourt. Il participe régulièrement aux 24 heures de la BD (événement organisé lors du festival d’Angoulême, lancé par Trondheim, et consistant à dessiner 24 planches en 24h autour d’un thème) et est même l’un des auteurs de l’album collectif sorti à cette occasion, Boule de neige (2007). Enfin, il a dessiné occasionnellement, avec d’autres blogueurs, quelques planches pour l’association-éditeur Nékomix dans deux de ses revues, Soupirs et Nékomix.
Malgré son succès, le blog en lui-même sort assez tardivement en une version papier. Si les publications papier de blogs commencent dès 2005, Notes sort chez Delcourt en 2008, et il en existe pour le moment trois tomes. Chacun d’eux reprend une partie des notes de blog dans l’ordre chronologique, avec quelques planches supplémentaires qui créent un fil directeur dans la lecture. Une manière pour lui de montrer à ses lecteurs de blog qu’il est également présent en librairie et peut-être aussi d’amener de nouveaux lecteurs qui ne connaîtraient pas le blog.
En 2005, il analyse ainsi, dans une interview donnée sur sceneario.com, la place que tient le blog dans sa carrière : « Le boulot de dessinateur consiste souvent à passer six mois à bosser et n’avoir de réaction que pendant les festivals: avec le blog j’ai trouvé le plaisir du spectacle, c’est comme avoir sa petite tribune et pouvoir sentir à chaud les réactions. Outre que ça soit très utile pour mieux capter ce qui fait réagir dans une BD, c’est aussi un formidable moteur pour bosser vu que la motivation est sans cesse renouvelée. De plus, la structure fait que c’est un très bon exercice vu qu’il faut se renouveler en permanence et produire le plus possible . »
L’art comique de Boulet :
S’il ne tenait qu’à moi, je dirais que Boulet fait partie des meilleurs talents de sa génération, et ce pour l’unique raison qu’il y a longtemps que je n’avais pas pris autant de plaisir à lire des planches de BD que depuis que je visite son blog. Mais je vais essayer de pondérer mon propos, d’être davantage objectif, et surtout d’argumenter !
On notera d’abord que Boulet est un auteur prolifique : en moins de dix ans, il a publié ou participé à près d’une vingtaine d’albums, sans compter l’édition de son blog. Blog qu’il met régulièrement à jour, tout en poursuivant sa participation à Tchô !. On pourrait encore ajouter les projets d’illustration sur lesquels il travaille comme, par exemple, la réalisation d’un livret illustré pour l’album Repenti du chanteur Renan Luce. C’est un auteur complet, tantôt scénariste, tantôt dessinateur, tantôt les deux à la fois. « Je travaille beaucoup. Mais c’est aussi que j’ai un graphisme qui permet une réalisation assez rapide. » dit-il, sur sceneario.com. Vous l’aurez compris, ce qui le caractérise le mieux est sans doute son imagination puissante dont le blog offre un aperçu intéressant. Elle permet une fantaisie graphique renouvellée par des images inattendues, comme dans cette planche décrivant un univers parallèle ( Février ).
C’est principalement dans le domaine de l’humour qu’il a jusque là fait ses preuves. Domaine délicat s’il en est, présentant toujours le risque de la répétition. Un des domaines où il excelle est la parodiea transposition et l, qu’il met d’ailleurs en oeuvre dans Tchô !, avec Raghnarok, parodie d’heroïc-fantasy dont le héros est un jeune dragon maladroit, mais aussi La rubrique scientifique. Il utilise le décalage comique entre la réalité, transpose une situation réelle dans un monde hypothétique. On retrouve là des formules qui avaient fait le succès de revues comme Pilote : pensons à l’humour basé sur le décalage dans Astérix ou aux parodies loufoques des Dingodossiers et de la Rubrique-à-brac de Gotlib. ( Tout le monde aux dodos ). L’âge d’or franco-belge est d’ailleurs souvent l’occasion de parodies jubilatoires, à la fois hommage et transgression des règles.(Schtroumpfs)
Boulet fait preuve, aussi bien dans ses albums papier que sur son blog, d’une bonne capacité de synthèse entre des influences extrêmement variées, tant au niveau du dessin que du scénario. On connaît ses goûts en matière de bande dessinée : les héros de Spirou, Calvin et Hobbes de Watterson (Fan art de la semaine ), Dr Slump de Akira Toriyama, Lewis Trondheim… (Copieur ) Une même diversité se retrouve sur le blog où il n’hésite pas à changer de style selon le type de note qu’il souhaite réaliser, voire à se livrer à des expériences graphiques (8bits le retour ; VIP ). Mais on la retrouvera aussi dans ses albums : les scènes de combat de Donjon reprennent en partie des codes graphiques du manga, intégrés à des formules plus européennes.
Enfin, il y a chez Boulet, je trouve, un certain classicisme dans l’humour, faisant appel aux ressources du comique de situation, de la parodie, du comique de répétition, ce qui rend ses gags souvent efficaces ; la narration est bien maîtrisée et mesurée, dans le sens où il sait faire passer un message avec un minimum de signes graphiques, comme on le voit dans certains gags muets (http://www.bouletcorp.com/blog/index.php?date=20090117 ). Mais ce classicisme efficace dialogue avec des images inattendues (dinosaures, monstres, zombies, extraterrestre) qui l’empêche de trop se répéter. Le comique vient assez souvent de la surprise du lecteur qui attend le gag et assiste à l’irruption de l’imprévu dans la routine.
En espérant que les quelques notes ainsi présentées vous aurons donné envie d’approfondir la lecture du blog ou des albums, pour ceux qui ne connaissaient pas encore Boulet !
Bibliographie de Boulet :
2001-2004 : Les Womoks, dessin de Reno, édité par Glénat (4 volumes)
2001-2009 : Raghnarok, Glénat (6 volumes)
2002-2005 : La rubrique scientifique, Glénat (3 volumes)
2005 : le Miya, Glénat
2006 : Soupir, Nékomix (collectif)
2006-2007 : Donjon Zénith, tomes 5 et 6, scénario de Joan Sfar et Lewis Trondheim, Delcourt
2007 : Boule de neige, Delcourt
2007 : Le voeu de Simon, dessin de Lucie Albon, La boîte à bulles
2008 : Nékomix 7, Nékomix (collectif)
2008-2009 : Notes, Delcourt
2008 : Chicou-chicou, Delcourt
Les citations viennent de cet interview donné en 2005 :
http://www.sceneario.com/sceneario_interview_BOULE.html