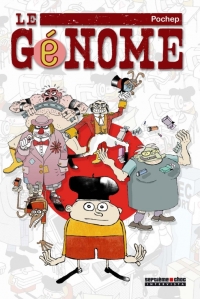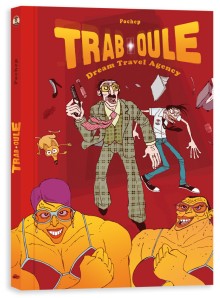Voici enfin arrivé le compte-rendu de notre table ronde du 12 mai dernier sur la bande dessinée numérique, organisée à l’école nationale des sciences de l’information et des bibliothèques. Pour ceux qui n’auraient pas pu y assister, nous vous rappelons que la table ronde a été captée en format audio. Vous pouvez l’écouter depuis le site de l’enssib, en deux parties.
Enfin, pour ceux qui souhaitent approfondir les questions de bande dessinée numérique, nous mettons à votre disposition une bibliographie sur le sujet, datée de mai dernier.
Nous sommes heureux d’avoir pu porter la discussion sur l’avenir de la bande dessinée numérique dans le cadre institutionnel de l’Enssib et ainsi mettre en lumière les rencontres, déjà existantes ou à venir, entre ce nouveau média et le monde des bibliothèques.
C’est dans le cadre d’une journée d’étude qu’il nous a été possible d’inviter et de réunir, le 12 mai dernier, Julien Falgas, responsable du site Webcomics.fr, Arnaud Bauer, éditeur de Manolosanctis.fr et Catherine Ferreyrolle de la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image.
La discussion a été introduite par un rappel des développements de ce nouveau média dans la
dernière décennie et une série d’exemples familiers aux lecteurs de ce blog (Zot, Prise de tête, etc.).
On y a également rappelé la distinction entre la BD numérique native (diffusée par les deux
premiers intervenants) et la BD numérique homothétique, c’est-à-dire issue de la numérisation
d’oeuvres déjà éditées sur papier aux fins de diffusion en ligne, ce que porte notamment le groupe Iznéo.
Des hébergeurs en charge d’une communauté
Julien Falgas a présenté Webcomics.fr, structure associative apparue début 2007, qui se présente comme une plate-forme d’hébergement permettant aux auteurs de publier au rythme qu’ils souhaitent sans nécessité de compétences techniques et d’échanger des commentaires avec leurs lecteurs. Animé par quatre passionnés bénévoles dont le développeur Julien Portalier et l’auteur Pierre Materne, Webcomics.fr héberge 1200 bandes dessinées produites par 55 auteurs.
De son côté, Arnaud Bauer est intervenu pour la structure Manolosanctis.fr, qui a été créée fin 2008 sur un principe proche mais avec le statut d’une entreprise qui publie par ailleurs des éditions papier.
Le site de Manolosanctis est dédié au web social par ses fonctions de recommandation, de partage sur des réseaux d’amis, d’échanges autour du contenu et de statistiques pour suivre le lectorat.
L’activité de ces sites s’apparentent beaucoup à celle de « community manager »du fait de
l’importance de l’animation et des possibilités d’échange de commentaires entre auteurs et lecteurs. Cela implique d’une part de mobiliser les contributeurs, d’autre part d’intervenir sur la hiérarchisation des contenus, à la manière de la modération intervenant sur des espaces collaboratifs comme Wikipedia. Les intervenants reconnaissent que cette animation ne doit pas cloisonner les communautés de lecteurs et de contributeurs des différents sites.
Il se trouve que les auteurs de commentaires les plus prolifiques se recrutent parmi les auteurs, ce qui accentue la dimension communautaire de la discussion en rendant possibles des observations réciproques.
Chez les deux hébergeurs, et contrairement à ce que pourrait laisser croire la fausse image
d’éditeurs en ligne qu’on leur attribue parfois, les auteurs ne sont pas rémunérés pour leurs
publications en ligne – ils le sont pour leurs publications papier dans le cas de Manaolosanctis. Tous les auteurs peuvent donc y être considérés comme amateurs, avec parfois une production de grande qualité mais où le niveau illustrateur débutant domine. Le web intervient comme un vecteur d’égalisation car il permet aux auteurs de toucher un large public sans dépendre d’abord d’un éditeur.
L’activité éditoriale constitue la deuxième couche de l’activité de Manolosanctis.fr: elle consiste à sélectionner les meilleures oeuvres pour les publier sur support papier. Une vingtaine d’albums ont ainsi été publiés, dont le récent Skins party.
A la recherche d’un modèle économique
Le marché de la bande dessinée numérique a surtout commencé à se développer du côté de la BD
homothétique avec l’apparition d’Iznéo, qui propose un catalogue de titres venant de la BD papier en version numérisée.
Très médiatisé, Iznéo a pour intérêt de renforcer la position des éditeurs face aux acteurs de
contenants, des fournisseurs d’accès comme Orange, par exemple. Le modèle d’acquisition proposé n’est pas celui de l’achat d’un oeuvre mais de l’accès à une version numérique ou à une application informatique de support, à la manière d’un jeu vidéo en ligne. Les copies acquises sur Iznéo ne peuvent être reproduites que 5 fois. Arnaud Bauer évoque l’intérêt du modèle du streaming: l’accès aux oeuvres en ligne peut être libre, mais l’utilisateur pourrait devoir en payer le téléchargement pour pouvoir disposer d’une copie.
La question de la diffusion à large échelle pose également celle d’un format intéropérable
comparable à ce qu’a été le mp3 dans le domaine de la musique. Ce sont pour le moment les
formats .zip et .pdf qui ont la faveur des lecteurs, mais les récentes évolutions du format epub ouvrent des perspectives quant à la diffusion de bande dessinée.
Le public est prêt à souscrire à des abonnements pour des flux de récits à consommer, mais il
privilégiera les séries et le cinéma. La bande dessinée numérique doit quant à elle tirer partie du caractère original et personnel de ses productions à petits moyens.
C’est ce qu’a commencé à faire Les Autres Gens avec une formule d’abonnement pour 2,50 euros par mois, qui a trouvé son public et permet aux auteurs de prendre l’initiative de publier sans recquérir
l’aval d’un éditeur.
Si Manolosanctis ne peut pour le moment valoriser qu’un petit catalogue d’albums papier, une
évolution de sa plate-forme est prévue pour janvier 2012 avec un catalogue d’oeuvres en ligne
« labellisé auteur » (là où Iznéo propose un catalogue « labellisé éditeur »), de manière à permettre à chaque auteur de trouver des acheteurs pour ses oeuvres. Pour Arnaud Bauer, la BD numérique a du sens et son aboutissement n’est pas forcément le papier.
Pour les éditeurs de BD numérique native, une opportunité serait de trouver des formes de récits qui sortent du traditionnel « gaufrier » imposé par le format papier. Or pour le moment, de nombreuses oeuvres publiées n’ont pas d’abord été conçue pour la lecture à l’écran. Mais l’utilisation d’une application flash ou l’apparition du Turbomédia pour l’affichage permet d’envisager le franchissement d’un palier dans ce domaine.
Quel support de lecture pour la BD numérique?
Interpellés sur l’absence de liseuse dédiée à la BD numérique, les intervenants ont rappelé que les coûts de développement d’un support spécifique (environ 10 millions d’euros) sont évidemment hors de leur portée. De plus, Arnaud Bauer a sérieusement mis en doute l’avenir des readers dédiés. Pour les éditeurs numériques, c’est le contenu qui prime dans la mesure où le support de lecture est de toute façon pris en charge par un autre acteur. Enfin il n’y a pas lieu de singer l’expérience de lecture sur album papier, album que l’on achètera si le premier jet numérique nous a plu.
La multiplication des supports de lecture (tablettes, liseuses, téléphones…) entraîne une bataille des normes entre producteurs pour parvenir à une position dominante.
Les intervenants ont été interrogés sur les caractéristiques de leur offre, privilégiant la lecture en html sur ordinateur: ne se base-t-elle pas sur le postulat d’une pagination, d’un format de récit essentiellement européen, voire franco-belge ? Arnaud Bauer explique avoir fait le choix de se cantonner au développement d’une offre web afin de ne pas multiplier les applications dédiées. Pour Julien Falgas, si cette offre évite le caractère réputé décevant de la lecture sur smartphone, elle a pour inconvénient de ne pas pouvoir être emportée offline.
Et les bibliothèques dans tout ça?
L’intervention sur les perspectives de la BD numérique en bibliothèque a été confiée à Catherine Ferreyrolle, qui a commencé par rappeler les missions de la CIBDI et notamment son expérience ancienne de numérisation de fonds de bande dessinée ancienne (le Rire, le Pierrot, les fonds de Caran d’Ache et Saint-Ogan).
Catherine Ferreyrolle reconnaît que les bibliothèques, submergées une offre de BD papier atteignant 4800 titres par an, ont peu avancé dans le domaine de la bande dessinée numérique. Néanmoins,plusieurs pistes sont déjà ouvertes dans le nécessaire rôle de prescription du bibliothécaire. il s’agirait, également à la manière d’un community manager, d’établir des listes, des signets à destination des lecteurs: « j’ai sélectionné ceci pour vous mais vous pouvez bien évidemment aller plus loin ».
Les bibliothèques sont concernées non seulement en tant que diffuseurs, mais aussi en tant
qu’acheteurs de contenus. En effet, leur rôle prescripteur ne saurait se limiter à une seule plateforme ou à l’offre gratuite. Se pose donc, outre la question des standards et des supports, celles de l’offre payante en général et en direction des bibliothèques en particulier.
Or pour Catherine Ferreyrolle les bibliothèques doivent à la fois promouvoir la bande dessinée
numérique et respecter les droits des auteurs. La question du droit de prêt n’ayant pas été résolue, elle constitue un frein au développement de l’offre de bande dessinée numérique. Un représentant d’Iznéo présent dans le public a abondé dans ce sens: le prêt existe déjà mais le droit de prêt existant sur papier n’a pas encore été transposé au numérique. D’autre par la circulation des fichiers prêtés apparaît comme une affaire délicate, mais la situation pourrait s’éclaircir d’ici quelques mois. Pour le moment, l’offre d’Iznéo en direction des bibliothèques consiste en un accès local et sur abonnement au catalogue, sans téléchargement, sur le modèle du streaming.
Les enjeux patrimoniaux, un défi à relever.
Côté bibliothèques, il apparaît nécessaire de développer des outils de consultation et de valorisation muséographique. Ainsi, la CIBDI, habituée à mettre en valeur de la planche et de l’imprimé, a présenté dernièrement des oeuvres d’auteurs asiatiques qui lui ont été adressées sous forme de fichiers numériques. La question se posait d’une présentation directe sur écran, en adéquation avec le support d’origine, , mais le choix a finalement été fait de les imprimer.
Pour Catherine Ferreyrolle, c’est du point de vue de la conservation de ce patrimoine que de
nombreux problèmes se posent: la BD numérique n’étant pas conservée comme telle en
bibliothèque, c’est sur les hébergeurs en ligne que repose pour le moment la pérennité de ces
oeuvres. La disparition récente d’un site consacré à la BD ancienne fait courir le risque de perdre une importante base de données sur les petits formats. De même, Julien Falgas signale que des productions BD diffusées sur le site apreslecole.com ne sont plus disponible en ligne aujourd’hui.
Le dépôt légal du web pourrait certes contribuer à sauvegarder ce patrimoine, mais l’absence
d’indexation des contenus régulièrement aspirés d’une part et l’inaccessibilité de certains contenus sans mot de passe d’autre part en limitent sérieusement l’utilité.
Nous espérons avoir fait de cette table ronde un pas de plus vers un investissement accru du
domaine de la BD numérique par les bibliothèques, que ce soit en matière de diffusion, de
valorisation, de conservation ou même d’aide à la création. Quoi qu’il en soit, nous en remercions les participants, des intervenants motivés et un public aussi attentif que réactif.
Antoine Brand (pour la restitution)
Julien Baudry
Antoine Torrens